
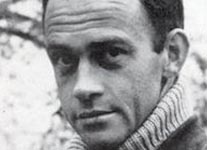

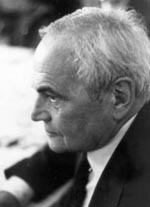
En septembre 1952, un journaliste de 23 ans, Bernard Frank, publiait dans la revue de Jean-Paul Sartre, Les Temps Modernes, une sorte de pamphlet qui s'en prenait à un groupe de jeunes écrivains, accusés de ne pas sacrifier aux dogmes de l'époque, accusés pour tout dire de "fascisme". En principe l'accusation qui tue . Mais l'article était intitulé "les grognards et les hussards". Il a fait date, car c'est essentiellement le titre qui en a été retenu, et il il a créé en quelque sorte le mythe des "hussards" en littérature, le mythe selon lequel il existerait à Saint-Germain-des-Prés une cohorte d'écrivains prétendument "fascistes" ayant pour chef de file un garçon de 27 ans, Roger Nimier, auteur, deux ans plus tôt, d'un best-seller intitulé "Le Hussard bleu".
A relire le pamphlet de Bernard Frank, un demi-siècle après sa première publication, ( Le Dilettante l'a réédité récemment) on se dit qu'il était superficiel et qu'il ne pouvait guère porter préjudice aux écrivains qu'il entendait pourfendre : les Jacques Laurent, Roger Nimier, Antoine Blondin (et Michel Déon qui fut, plus tard, ajouté). Il n'empêche que ce modeste article a eu un double mérite : le mérite pour Bernard Frank, de se faire instantanément un nom, et le mérite d'avoir donné une grande notoriété à cette soi-disant coterie des "hussards". (Pour l'anecdote, signalons que Bernard Frank donnera paradoxalement des articles à La Parisienne, la revue phare des "hussards" !).
Certains pensent que Bernard Frank n'est d'ailleurs pas l'inventeur du mot de "hussards" pour désigner ces jeunes écrivains "dégagés" (par opposition aux écrivains engagés). C'est l'écrivain belge Willy de Spens qui en aurait eu la paternité, selon les exégètes les plus pointus. De Spens, excellent écrivain, trop peu lu, décédé il y a quelques années, avait publié, dans la série de ses souvenirs, un livre intitulé "Le hussard malgré lui". Un titre à la Nimier. Mais peu importe : parce que Bernard Frank était un homme classé à gauche, et parce qu'il s'était exprimé dans une revue d'extrême gauche, Les temps modernes, dont le magistère était considérable, à l'époque, la formule passa à la postérité, et les "hussards" surent d'ailleurs retourner à leur profit cette étiquette qui, en dernière analyse, n'avait rien d'insupportable.
L'histoire des "hussards" doit beaucoup au hasard. Seules des rencontres de circonstance, des amitiés et des confraternités éphémères, ont réuni à jamais leurs noms . Ils ont néanmoins un point commun : ils ont tous subi, à un moment ou à un autre de leur jeune existence, l'influence de l'Action française. Et puis, hommes de la même génération, celle de l'immédiat après-guerre, ils arrivent sur un terrain littéraire relativement vierge : d'un côté il y a certes le clan des Sartre et des Camus, le clan des affiliés au CNE, ce Comité National des Écrivains, qui a entrepris d'épurer les lettres françaises. Mais de l'autre côté, il n'y a plus rien; il n'y a que les "maudits", les interdits professionnels. Une liste a en effet été dressée de ceux dont il est désormais interdit de publier et de diffuser les ouvrages. Cette liste va de Pierre Benoît à Paul Morand en passant par Guitry et Giono. Et puis il y a Mauriac tout seul.
Les "hussards", eux, ne figurent pas sur la liste des interdits professionnels, car ils étaient trop jeunes pour avoir publié des oeuvres significatives sous l'Occupation. Et d'ailleurs Roger Nimier finit la guerre, à 19 ans, incorporé volontaire dans les rangs du 2ème régiment des hussards (un signe ! ). Il aurait été mal venu de l'interdire de publication, pour cause de complaisance avec l'ennemi ! Ce qui caractérise les "hussards", en fin de compte, c'est une réaction, la réaction à l'air du temps, la réaction au roman engagé (à gauche), la réaction au caporalisme des communistes et de leurs compagnons de route, ces chiens de garde de la pensée unique, dont Jean-Paul Sartre est le plus pesant des représentants, avec son existentialisme envahissant et totalitaire. Oui, les "hussards" sont "réactionnaires" dans la mesure où ils réagissent et s'opposent au discours dominant. Dans "Paul et Jean-Paul" (1951), Jacques Laurent se livre à un parallèle entre Paul Bourget et Jean-Paul Sartre, pour montrer la persistance, à toutes les époques, des conformismes les plus insupportables. Ce n'est pas en elle même la critique de Sartre et de ses thèses qui fit mouche, avec ce pamphlet, mais c'était d'avoir osé comparer l'œuvre du chef de file des existentialistes à celle des romans bourgeois de la fin du XIXe siècle ! La blessure fut vivement ressentie, et le combat entre les "hussards" et les sartriens ne fit alors que commencer.
Le positionnement politique des "hussards" ne peut être séparé du contexte de la guerre froide, de la menace communiste de l'époque. Mais c'est vrai qu'il serait très réducteur de présenter les "hussards" comme des écrivains engagés. Ce sont d'abord et avant tout des romanciers. Et dans le roman, ils deviennent réellement ce qu'ils prétendent être : des auteurs "dégagés". Même si, pour l'époque, proclamer son dégagement littéraire, c'est déjà se positionner politiquement (à droite).
Dernière caractéristique commune aux "hussards" : leur volonté de réhabiliter les épurés de 1944. Roger Nimier prend sous son aile protectrice André Fraigneau et Jacques Chardonne; Antoine Blondin fait l'apologie de Robert Brasillach et de Lucien Rebatet, Dans" La Parisienne", son journal mensuel, qui va paraître de janvier 1953 à mars 1958, Jacques Laurent accueille Marcel Jouhandeau, André Fraigneau, Jean Giono, Henry de Montherlant, Jacques Chardonne, Paul Morand, Robert Poulet.
Il est temps, maintenant, de présenter ces fameux "hussards". Et d'abord le chef de file : Roger Nimier (1925-1962). Il est mort dans un accident de voiture à 37 ans, trop jeune pour avoir donné la plénitude de son oeuvre. Néanmoins il laisse une douzaine de livres, dont ce fameux (et scandaleux) "Hussard bleu". Nimier, au delà de son oeuvre inachevée, fut un extraordinaire animateur, un agité, qui sut tirer le meilleur parti de son paresseux ami Antoine Blondin, sauver de l'oubli Chardonne et Fraigneau, faire préfacer les "Livres de Poche" par les meilleures plumes de la droite littéraire.
Puis vient Antoine Blondin. C'est peut-être, paradoxalement, le plus connu des "hussards", en tout cas, l'un de ceux cités le plus souvent, à la télévision, dans la presse. Ses chroniques sportives de L'Équipe ont fait davantage pour sa notoriété que ses cinq romans. "Un singe en hiver" est toutefois devenu un film à succès, avec Belmondo et Gabin, Belmondo dans le rôle de Blondin. Les deux hommes se ressemblaient d'ailleurs un peu, de visage.
Jacques Laurent est le troisième "hussard". Né en 1919, mort récemment, Laurent est certainement le plus fécond, le plus puissant , le plus éclectique des "hussards". Il a écrit une centaine d'ouvrages sous une quinzaine de pseudonymes différents, le plus connu de ces noms d'emprunt étant Cécil Saint Laurent. Jacques Laurent, ce sont des romans importants, comme "Les Corps tranquilles", ou "Les Bêtises" (prix Goncourt), c'est "Le petit Canard", sorte de lettre d'amour d'un père à son fils qui va être fusillé, ce sont des petits essais comme "le français en cage", qui sont de purs chefs d'œuvre, écrits par un amoureux de la langue française. Cécil Saint Laurent, ce sont des sagas politiques et légères, comme la série des "Caroline chérie", "Hortense", "Clotilde", "La Communarde". ce sont des ouvrages plus franchement érotiques, mais sous d'autres signatures ou sous les mêmes. Il y a aussi des livres pour enfants, des essais politiques, des études historiques (sous le pseudonyme d'Albéric Varenne). Enfin Laurent écrivit de nombreux scénarios et dialogues de films, y compris des films historiques consacrés à la guerre de 14-18 ou à la bataille de France.
Quant à Michel Déon, il vit toujours, quelque part entre Paris, l'Irlande et la Grèce. "Les Poneys sauvages" et "Le Taxi mauve" (et le film qui en a été tiré, avec Charlotte Rampling et Fred Astaire), son élection à l'Académie française, ses légendaires promenades dans les îles grecques, ont sculpté une imposante statue. une statue solide. Le critique belge Pol Vandromme, dans son essai sur Déon, écrit ceci : "Blondin (qui toréait les mots pour estoquer les calembours), Nimier (qui ravalait la mélancolie romantique et ferraillait dans le parc du château de Verrière), Laurent (qui complotait en cagoulard intellectualiste) avaient le joli cœur et l'uniforme brodé des hussards de l'imagerie. Déon, à côté d'eux, semblait plus fantassin que cavalier (...) Il n'avait pas la légende parisienne (...)".
Voilà donc les quatre "hussards". Aujourd'hui ils s'éloignent un peu, dans notre mémoire; ils ont cette couleur noir et blanc des actualités des années cinquante, ils laissent derrière eux des livres, des films, des articles, la rumeur de batailles de mots qui n'ont plus cours, car le monde a changé. Mais à feuilleter leurs journaux et leurs revues : la Parisienne, Arts, La Nouvelle Lanterne, Accent grave, Opéra, Le Nouveau candide , les tribunes du Combat des années Smadja-Tesson, on se dit que cette "droite buissonnière", pour reprendre l'expression de Pol Vandromme, mérite toute sa place au panthéon des lettres. Et pas seulement là.
Francis Bergeron